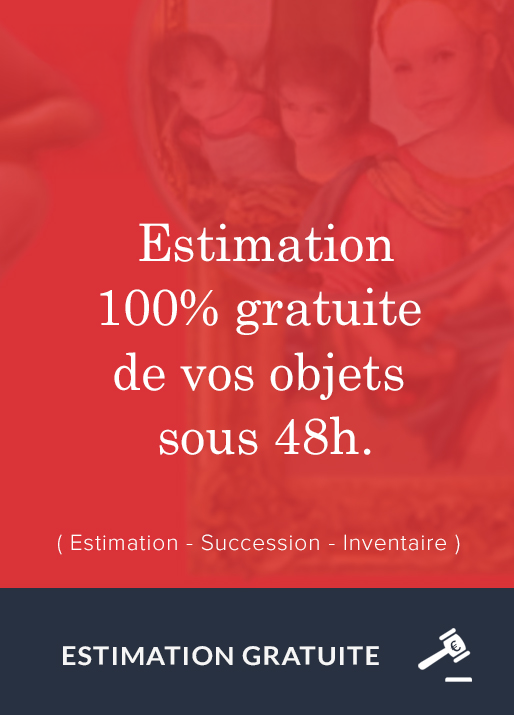Découvrez comment la cote des œuvres de Jean Tinguely (1925‑1991) se forme et évolue sur le marché de l’art contemporain. Sculptures cinétiques, dessins, peintures : chaque création possède une valeur spécifique. Ce guide vous offre des repères clairs pour comprendre les fourchettes de prix et préparer une estimation sérieuse. Demandez l’expertise d’un commissaire‑priseur spécialisé pour connaître la valeur réelle de votre œuvre.
Cote, valeur et estimation des œuvres de Jean Tinguely (1925‑1991)
Comprendre la cote de Jean Tinguely
La valeur d’une œuvre de Jean Tinguely est déterminée par plusieurs critères :
- Technique et support (sculpture cinétique, dessin, peinture, reliefs mécaniques…)
- Rareté et taille de l’édition (pièce unique, tirage limité)
- État de conservation et bon fonctionnement des mécanismes
- Provenance et documentation (certificats, archives, catalogues raisonné)
- Forces actuelles du marché de l’art moderne et contemporain, notamment en Europe
Sculptures cinétiques (métal, mécaniques, automates)
Les sculptures mobiles de Tinguely, souvent composées d’éléments métalliques mécaniques en mouvement, constituent le cœur de son œuvre.
- Petites sculptures de table : de 20 000 € à 150 000 €
- Œuvres de taille moyenne : entre 100 000 € et 500 000 €
- Grands automates : de 300 000 € à plusieurs millions d’euros
Reliefs et assemblages mécaniques
Ces pièces intermédiaires entre sculpture et murales mécaniques se situent entre 100 000 € et 400 000 €.
Dessins et œuvres sur papier
- Esquisses simples : 5 000 € à 25 000 €
- Dessins plus aboutis : 25 000 € à 100 000 €
Peintures, lithographies et sérigraphies
- Impressions signées : 2 000 € à 20 000 €
- Peintures rares : 30 000 € à 150 000 €
Objets expérimentaux ou prototypes
Prix entre 10 000 € et 80 000 € selon la rareté et l’originalité de la pièce.
Tableau récapitulatif des fourchettes de prix
| Type d’œuvre | Fourchette estimative (€) |
|---|---|
| Sculptures cinétiques (petite taille) | 20 000 € – 150 000 € |
| Sculptures cinétiques (moyenne taille) | 100 000 € – 500 000 € |
| Grands automates mécaniques | 300 000 € – plusieurs millions € |
| Reliefs/assemblages mécaniques | 100 000 € – 400 000 € |
| Dessins sur papier | 5 000 € – 100 000 € |
| Lithographies/sérigraphies | 2 000 € – 20 000 € |
| Peintures rares | 30 000 € – 150 000 € |
| Objets expérimentaux/prototypes | 10 000 € – 80 000 € |
Jean Tinguely (1925‑1991) : parcours, influences et héritage
Jean Tinguely (1925‑1991) : parcours, influences et héritage
Jean Tinguely naît le 22 mai 1925 à Fribourg en Suisse. Issu d’une famille d’artistes — son père était peintre — il se détourne d’abord des arts pour suivre des études techniques à Zurich, puis fréquente l’École des Arts Appliqués de Bâle, où il étudie l’architecture industrielle et la peinture.
Premiers pas et influences (années 1940‑1950)
Après la guerre, Tinguely découvre l’abstraction, le constructivisme et surtout le dadaïsme, avec son rejet des certitudes artistiques. Il est vivement marqué par le travail de Marcel Duchamp, ainsi que par les productions cinétiques de la sculpture mobile européenne. En 1949, à Bâle, il rejoint le mouvement dadaïste local où germe une fascination pour l’humour, le mouvement et l’assemblage spontané.
L’aventure cinétique et la naissance des machines poétiques (années 1950‑1960)
En 1953, Tinguely présente ses premières « métamécaniques », sculptures faites d’éléments récupérés, parfois en mouvement, souvent absurdes et comiques. Il remet en question les catégories traditionnelles de l’art. Son œuvre devient une critique de la société industrielle, à travers des machines poétiques qui s’enfoncent dans le « non‑finito », la temporalité et le dérisoire.
En 1959, il réalise Homage to New York, une sculpture auto‑destructrice présentée au MoMA à New York, symbole de son esprit révolutionnaire. Cette performance marque l’entrée de Jean Tinguely sur la scène internationale.
Reconnaissance mondiale et grandes pièces (années 1960‑1970)
Au cours des années 1960, Tinguely produit des installations mécaniques monumentales comme Cyclops ou Heureka, alliant performance, sculpture et son automatisé. Il collabore avec des artistes comme Niki de Saint Phalle (avec qui il fonde le couple mythique du mouvement Nouveau Réalisme), Daniel Spoerri, et les membres du Surréalisme tardif.
Son exil partiel le mène à Paris, mais aussi aux États-Unis — notamment à New York — où il bénéficie d’une forte reconnaissance artistique. En 1970, il crée des fontaines cinétiques (dont celles de Stravinsky à Paris) et travaille sur des pièces publiques et architecturales.
Années 1980‑1991 : maturité, hommage et transmission
À partir des années 1980, Tinguely installe des œuvres dans des espaces muséaux et publics en Europe, en Suisse et au Japon. Son art intègre de plus en plus la couleur, le son et l’espace paysager. En parallèle, il documente ses pièces à travers dessins, esquisses, carnets d’atelier et lithographies.
Il s’intéresse aussi à la création de pièces pédagogiques, à destination du jeune public, soulignant la poésie du mouvement mécanique.
Jean Tinguely décède le 30 août 1991 à Berne. Il laisse une œuvre protéiforme : machines cinétiques, performances collectives, dessins d’atelier, sculptures monumentales.
Un héritage pluriel : contexte historique et postérité
Tinguely s’inscrit dans le sillage du Nouveau Réalisme, mouvement initié en 1960 par Pierre Restany, cherchant à intégrer l’objet industriel et le quotidien dans l’art. Parallèlement, il reprend l’héritage de Duchamp, tout en développant une critique ludique du consumérisme.
Son travail fédère des disciplines : sculpture, performance, dessin, installation, architecture mécanisée. Traditionnellement, ses œuvres invoquent le déséquilibre contrôlé, le hasard, la décomposition, et la mémoire urbaine.
Aujourd’hui, ses œuvres sont exposées dans de grands musées modernes, muséums d’art contemporain, et font l’objet de rétrospectives régulières, notamment en Suisse, en France et aux États-Unis. Sa pensée influence l’art technologique contemporain et la sculpture interactive.
Périodes clés récapitulatives
- 1945‑1953 : Formation, dada bâlois, premiers assemblages.
- 1953‑1960 : Métamécaniques, performances destructrices.
- 1960‑1970 : Grandes machines, reconnaissance internationale, Nouveau Réalisme, fontaines publiques.
- 1970‑1991 : Œuvres colorées, dessins, installations publiques, transmission artistique.